Étiquettes
anne rice, enter night, gladstone, illuminati, michael rowe, michel talbot, non traduits, richard laymon, roman vampire, roman vampire anglophone, rudy pasko, skipp, spector, splatterpunk, the delicate dependency, the light at the end, the travelling vampire show, vampire
Petit aperçu de 4 livres américains qui ont marqué ou marqueront l’histoire du vampire mais n’ont jamais été traduits en français, pour des raisons qui n’ont rien à voir avec leurs grandes qualités littéraires.
The delicate dependency, Michel Talbot
 Ecrit en 1982, la première édition de ce roman est introuvable, même en anglais, jusqu’à sa republication en 2014 par Valancourt books. Le livre est pourtant souvent cité aux USA comme l’un des meilleurs récits de vampire jamais écrit. Et je confirme. Je me le suis procuré sur les précieux conseils d’Adrien « Mr Vampirisme.com » Party, qui tenait le tuyau de Jean-Daniel Brèque.
Ecrit en 1982, la première édition de ce roman est introuvable, même en anglais, jusqu’à sa republication en 2014 par Valancourt books. Le livre est pourtant souvent cité aux USA comme l’un des meilleurs récits de vampire jamais écrit. Et je confirme. Je me le suis procuré sur les précieux conseils d’Adrien « Mr Vampirisme.com » Party, qui tenait le tuyau de Jean-Daniel Brèque.
Londres, sous le règne de Victoria. Après la mort de sa femme des suites de la grippe, le docteur Gladstone vit seul avec ses deux filles et se plonge à cœur perdu dans la recherche, inventant une souche mutante du virus qui a emporté son aimée. Une nuit, il renverse un beau jeune homme, qu’il lui semble avoir déjà vu enfant. Il l’avait pris pour un ange. Il l’accueille chez lui pour le soigner, et réalise bientôt qu’il a vraiment affaire à une créature surnaturelle, qui le charme lui tout autant que ses filles, et semble très intéressé par ses recherches.
Chez Talbot, plus que de vulgaires suceurs de sang, les vampires sont des immortels alchimistes, et forme une société secrète, celle des Illuminatis, qui garde jalousement ses découvertes et technologies avancées, en préservant l’histoire dans leurs maisons musées, veillant sur la race humaine dans l’ombre. Ils collectionnent dans leurs rangs les êtres exceptionnels, aux talents rares, des autistes savants, des beautés, ou des génies. Le summum de l’élitisme. Friands d’énigmes et de puzzles, affreusement manipulateur même si non meurtriers, ils sont fascinants. Le narrateur sera leur jouet, et devra, comme le lecteur, déjouer leurs nombreuses machinations, leurs jeux sadiques, à la manière d’un Sherlock Holmes, sombrant dans la paranoïa la plus totale. « Ne faites jamais confiance à un vampire » le prévient l’angélique Niccolo au début du livre, et cela s’avérera un conseil des plus judicieux.
J’ai dévoré le livre en trois jours, il m’a procuré des émotions voisines au Voleur de Voix, cette trilogie québécoise, où un vampire fou enlève les grands chanteurs d’opéra à travers l’histoire. J’ai trouvé chacun des personnages finement ciselé, la mythologie est riche, très originale par moment , et on ressent profondément ce que signifie être immortel, avoir des perceptions supranormales, former une société à part de la race humaine. C’est sûrement l’une des excursions les plus réussies dans l’esprit d’un vampire. Michel Talbot écrit vraiment bien et enchaîne les retournement de situations, la tension est à son comble jusqu’aux révélations finales, certaines renversantes et particulièrement machiavéliquement amenées. L’auteur semble aussi érudit que ses personnages : le bouquin fourmille de détails sur la société victorienne, et sur plusieurs pans de l’histoire de Charlemagne aux Médicis.
S’il reprend le thème de Carmilla en incipit, (un joli vampire apparemment inoffensif qui s’introduit dans la maison d’un notable après qu’il l’ait sauvé d’un accident pour s’attaquer ensuite à sa fille), ou bien celui de la nouvelle du comte Steinbock (où le vampire vole l’enfant prodige à son père), on sent surtout l’influence d’ Anne Rice par rapport à la beauté de certains personnage, leurs sens surdéveloppés qui permettent de magnifier le monde, leur aura, ou leur propension à collectionner œuvres d’arts et bien matériels. Mais au final, c’est elle qui s’est nourrie de The Delicate Dependency en retour pour l’écriture de Lestat le vampire, sorti quelques 3 ans après sa publication, notamment concernant le personnage de Marius, mélange du Lodovico de Talbot, maître vampire florentin avide de connaissance et de son Des Esseintes, prêtre et alchimiste gaulois. Son Niccolo a aussi très certainement influencé la redéfinition du Armand de Rice, présenté dans Lestat le vampire comme un chérubin, un jeune homme d’à peine 17ans. (Son âge n’est pas mentionné dans Entretien avec un vampire). Tout comme Niccolo pour Léonard de Vinci, Armand a posé pour le peintre Marius, qui le représenta sous forme d’un ange. Autre similitude, à l’instar du Docteur Gladstone, Lestat part à la recherche de l’histoire des vampires et rencontre des grands anciens. The delicate dependency se présente donc comme le chaînon manquant entre Entretien avec un vampire et Lestat le vampire, peut-être même aura-t-il poussé Anne Rice à écrire cette suite presque dix ans après. Un grand malheur que l’œuvre de Michel Talbot n’ait jamais été traduite et soit restée rare aussi longtemps en anglais. Si j’étais mauvaise langue, j’aurais tendance à dire que ce fait aura bien arrangé Anne Rice…
The Light at the End, John Skipp et Craig Spector
 Étiqueté « splatterpunk », ce roman me faisait de l’œil depuis un moment déjà. Et bien je n’ai pas été déçue de cet effrayant voyage dans les méandres du métro New-yorkais. Il a été écrit à deux mains, par deux trublions musiciens, scénaristes, qui sont notamment aussi responsable de la novelisation de Fright Night.
Étiqueté « splatterpunk », ce roman me faisait de l’œil depuis un moment déjà. Et bien je n’ai pas été déçue de cet effrayant voyage dans les méandres du métro New-yorkais. Il a été écrit à deux mains, par deux trublions musiciens, scénaristes, qui sont notamment aussi responsable de la novelisation de Fright Night.
S’il est inconnu en France, The Light at the end a certainement eu une grande place dans l’histoire du suceur de sang au cinéma et en littérature. Paru en 1986, c’est à dire 2 ans après Vampire Junction, et un an après Lestat le Vampire, il met en scène le prétentieux, et narcissique Rudy Pasko, street artist nihiliste au look new wave et aux cheveux peroxydés récemment devenu vampire. Ravi de faire parti du monde des ténèbres, celui-ci saigne New York jusqu’à la lie. Un groupe de geeks fans de cinéma bis, menés par Joseph Hunter, un type qui se prend pour un justicier, et Armond Hardocian, vieillard rescapé des camps, fera tout pour l’arrêter.
Rudy Pasko fait donc partie de ces vampires littéraires surfant sur la vague post-punk. Mais c’est lui qui y va le plus franchement, précédant l’Âmes Perdues de Poppy Z Brite, avec qui il partage de nombreuses similitudes, l’écriture vénéneuse en moins. Il aura peut-être inspiré, de par son look et son attitude, David et Severen de Génération perdue et Aux Frontières de l’Aube, sortis l’année d’après en 87. Et bien évidemment Spike de Buffy.
Il semblerait même que The Light at the End soit une sorte de premier brouillon de The Strain (écrit à deux mains aussi, pour l’anecdote), de par l’infestation de vampire dans New York, la place qu’y occupent les sous-terrains du métro, l’équipe de bras cassés venue de tout horizon qui s’improvise chasseurs, et la présence du maître vampire dans un camp de concentration.
Malgré quelques incohérences un peu dérangeantes (comportement des personnages irresponsables ou illogiques) le livre reste surprenant, les personnages sortent des rôles classiques qu’ont leur attribut au début, le sous-fifre Stephen ne deviendra pas le Renfield de Rudy, et la gothique fan de vampire ne sera pas changé en sa Reine de Ténèbres. Rudy Pasko, présenté comme le big bad wolf, s’en prend plein le museau, et est humilié à chaque fois qu’il fait le malin, ce qui dote le livre d’une bonne dose d’humour. Il a aussi une vraie portée post-moderne, puisque Rudy tire des enseignements de la lecture d’Entretien avec un vampire, et fais un massacre dans un cinéma devant le film Gore Feast.
C’est aussi assez plaisant de se replonger en ce temps où les téléphones portables n’existaient pas et où les chasseurs de vampires communiquent à coups de bipeurs et de cabines téléphonique. Tout une partie de l’intrigue repose même là-dessus. Bref, si vous lisez l’anglais, c’est un indispensable dans votre collection !!!
Enter, night, Michael Rowe
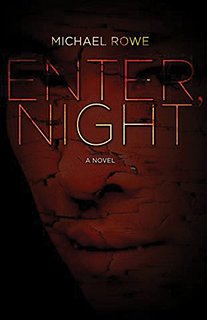 Tout le monde revient à Parr’s Landing, petit village minier enclavé et réac dans le nord du Canada. Cristina Parr est obligée de rentrer dans sa ville natale avec sa fille unique après la mort de son mari. C’est bien malgré elle qu’elle quitte Toronto pour affronter sa belle mère, l’affreuse Adeline Parr qui règne en tyran sur la région. Mais arrive aussi le tueur maniaque Richard Weal qui se prend pour un vampire depuis qu’il a fait des fouilles archéologiques sur un site indien vingt ans auparavant dans les environs de Parr’s landing. Il est bien décidé à excaver l’horreur qui se terre dans les sous-terrains de la mine, monstre anthropophage que les indiens nommaient wendigo.
Tout le monde revient à Parr’s Landing, petit village minier enclavé et réac dans le nord du Canada. Cristina Parr est obligée de rentrer dans sa ville natale avec sa fille unique après la mort de son mari. C’est bien malgré elle qu’elle quitte Toronto pour affronter sa belle mère, l’affreuse Adeline Parr qui règne en tyran sur la région. Mais arrive aussi le tueur maniaque Richard Weal qui se prend pour un vampire depuis qu’il a fait des fouilles archéologiques sur un site indien vingt ans auparavant dans les environs de Parr’s landing. Il est bien décidé à excaver l’horreur qui se terre dans les sous-terrains de la mine, monstre anthropophage que les indiens nommaient wendigo.
Roman canadien de 2011, Enter, night, se situe entre Salem de King et Necroscope de Lumley. Salem, parcequ’avant tout on s’intéresse à la vie du village, à ses habitants, à leurs secrets, et aucun n’est à l’abri de revenir d’entre les morts dévorer ses proches, et que l’histoire se passe dans les seventies, ce qui explique l’esprit étroit ambient. Necroscope pour le vampire enterré que son terrible fidèle vient libérer.
Même si Rowe explore des sentiers maintes fois rebattus, que ses personnages sont tous des archétypes, il le fait avec un charme désarmant pour un premier roman, et dès les premières pages on est happé par l’histoire pour ne plus la lâcher. Rowe est un formidable conteur et chaque personnage, très sympathique, possède un background touchant, soigneusement mis en relief, que ce soit le plus jeune fils Parr, homosexuel, que sa mégère de mère a essayé de guérir à coup de torture dans un asile psychiatrique, Finnegan, jeune garçon solitaire ayant sa chienne pour seule amie, qui regarde avec passion Dark Shadows et tombe amoureux de Dracula après l’avoir découvert dans un comic book, ou Bill Lighting, l’indien professeur en anthropologie qui fut arraché à ses parents biologiques à 6 ans pour être christianisé violemment dans un orphelinat. Les personnages ont tous en commun le deuil, et s’ils sont marginaux, dans leur passé, on a essayé de les remodeler en ce qu’ils n’étaient pas.
Le véritable vampire n’apparait qu’à la 150ème page du roman, bien qu’il soit présent en sous-texte avant, dans le personnage d’ogresse d’Adeline Parr, dans le serial killer Richard Weal, ou dans la ville elle-même, qui étouffe ses habitants. Le suceur de sang est le mal incarné, est sujet aux métamorphoses monstrueuses (dents et ongles disproportionnés, ailes de chauve-souris) se répand par contagion, et possède de formidables pouvoirs psychiques d’illusions, de télépathie, qui sont ici fort bien exploités. Assez rare pour être souligné, Enter, Night introduit une chienne vampire, et le chapitre qui la met en scène est incroyablement émouvant et horrible à la fois, j’ai même versé ma petite larme quand l’animal marche au soleil pour épargner son petit maître de son appétit. Le jeune Finnegan perd son innocence et devient un homme en regardant l’amie qui l’a accompagné toute son enfance réduite en cendre. Là encore, on pense au Cujo de King. Soulignons également l’érotisme du roman, certains passages vampiresques sont chauds bouillants ! Le premier roman de Michael Rowe, hommage assumé au maître de la terreur, est un régal à lire. Un talent à suivre de prêt.
The Travelling vampire show, Richard Laymon.
 Richard Laymon aurait dû être une star de l’horreur au même titre que Jack Ketchum ou Dean Koontz. Pourtant, à cause de mauvaises couvertures, il n’a jamais totalement percé aux Etats Unis, mais il est pourtant célèbre en Angleterre et en Australie. La France est malheureusement également passée à côté de son talent. The travelling Vampire show est l’un de ses romans primé, et c’est par lui que je l’ai découvert.
Richard Laymon aurait dû être une star de l’horreur au même titre que Jack Ketchum ou Dean Koontz. Pourtant, à cause de mauvaises couvertures, il n’a jamais totalement percé aux Etats Unis, mais il est pourtant célèbre en Angleterre et en Australie. La France est malheureusement également passée à côté de son talent. The travelling Vampire show est l’un de ses romans primé, et c’est par lui que je l’ai découvert.
En 1963, dans une petite ville américaine, on attend l’arrivée du cirque itinérant, pour voir la sublime Valéria, une vampire en captivité. Le spectacle aura lieu sur un terrain vague en dehors de la ville, qui possède une histoire macabre de meurtres et de disparitions. On suit trois adolescents pendant une journée, qui vont tout faire pour voir le spectacle bien qu’il soit interdit au moins de 18 ans.
The travelling vampire show est plus un roman à la Stand by me qu’un roman de vampire, il faudra attendre la toute fin de l’histoire pour en voir un. Mais le suspense fonctionne et on attend les dernières pages, lent cheminement vers l’horreur la plus totale. Les thèmes explorés sont l’amitié, le courage et l’éveil de la sexualité, une coming of age story qui pourrait paraître assez banale, mais de temps en temps, pour satisfaire au genre splatterpunk dont il est une figure de proue, Laymon distille des horreurs innommables sur le passé des trois personnages principaux. Malgré quelques redondances dans le style, et deux trois trucs assez improbables, je recommande fortement ce livre aux fans de King et Robert Mc Cammon.








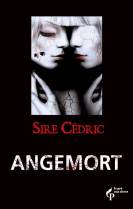



 Dans l’imaginaire américain, la Nouvelle-Orléans, c’est la capitale de la prostitution, de la luxure et de la dépravation. Un Amsterdam sudiste, qui obéit à ses propres lois ; patrie du vaudou et du crime, des bordels et des casinos, celle que l’on surnomme “City of Sins” est intrinsèquement porteuse de l’Eros et du Thanatos. Et si elle attire les touristes, elle appâte aussi les non morts : le Lestat de la célèbre Chronique des vampires d’Anne Rice (commencée en 1976 par Entretien avec un vampire) ainsi que le jeune gothique Nothing et sa bande de marginaux crasseux et cannibales, dans le traumatisant Âmes Perdues (1991) de la papesse de la littérature queer underground, Poppy Z Brite. Ces amateurs d’hémoglobine ont donc décidé de cacher leurs cercueils dans le bayou : marécages, maison de planteurs et alligators sembleraient offrir une équivalence acceptable aux forêts profondes, châteaux transylvaniens et aux loups. L’emménagement du vampire sur les berges du Mississippi se poursuit de nos jours encore avec le True Blood du génial Alan Ball, estampillée HBO et adapté des livres de Charlaine Harris.
Dans l’imaginaire américain, la Nouvelle-Orléans, c’est la capitale de la prostitution, de la luxure et de la dépravation. Un Amsterdam sudiste, qui obéit à ses propres lois ; patrie du vaudou et du crime, des bordels et des casinos, celle que l’on surnomme “City of Sins” est intrinsèquement porteuse de l’Eros et du Thanatos. Et si elle attire les touristes, elle appâte aussi les non morts : le Lestat de la célèbre Chronique des vampires d’Anne Rice (commencée en 1976 par Entretien avec un vampire) ainsi que le jeune gothique Nothing et sa bande de marginaux crasseux et cannibales, dans le traumatisant Âmes Perdues (1991) de la papesse de la littérature queer underground, Poppy Z Brite. Ces amateurs d’hémoglobine ont donc décidé de cacher leurs cercueils dans le bayou : marécages, maison de planteurs et alligators sembleraient offrir une équivalence acceptable aux forêts profondes, châteaux transylvaniens et aux loups. L’emménagement du vampire sur les berges du Mississippi se poursuit de nos jours encore avec le True Blood du génial Alan Ball, estampillée HBO et adapté des livres de Charlaine Harris. Le vampire gay n’est cependant pas que l’apanage du Mississippi. En effet, bien avant Entretien avec un vampire, Carmilla initiait la jeune et innocente Laura aux amours saphiques, tandis que le héros vampire du Comte Stenbock, Vardalek, séduisait un jeune garçon, dans la courte nouvelle L’histoire vraie d’un vampire que l’on a souvent accusé de plagier Carmilla. Le comte Stenbock offre pourtant une version très moderne du vampire, dont Lestat fait écho de façon frappante, que ce soit dans la séduction, l’orientation sexuelle, la blondeur, ou l’amour de la musique.
Le vampire gay n’est cependant pas que l’apanage du Mississippi. En effet, bien avant Entretien avec un vampire, Carmilla initiait la jeune et innocente Laura aux amours saphiques, tandis que le héros vampire du Comte Stenbock, Vardalek, séduisait un jeune garçon, dans la courte nouvelle L’histoire vraie d’un vampire que l’on a souvent accusé de plagier Carmilla. Le comte Stenbock offre pourtant une version très moderne du vampire, dont Lestat fait écho de façon frappante, que ce soit dans la séduction, l’orientation sexuelle, la blondeur, ou l’amour de la musique. Cependant, si la tête et les crocs sont phalliques, la bouche du vampire est un contenant qui accueille le liquide au lieu de le déverser. La sangsualité
Cependant, si la tête et les crocs sont phalliques, la bouche du vampire est un contenant qui accueille le liquide au lieu de le déverser. La sangsualité 

 Tout au long du show d’Alan Ball, vampires et gays sont intrinsèquement liés : d’ailleurs plusieurs vampires ont des penchants homosexuels. Le personnage de vampire gay le plus signifiant quant à la persécution des homosexuels est sans doute Eddy ; Allan Ball ne se gêne pas pour inverser les valeurs, et Eddy deviendra la victime d’humains qui le séquestrent et le torturent pour prendre son sang (le sang des vampires est un aphrodisiaque puissant). Tout change de place de façon perceptible, puisque le mort-vivant est ici un homme d’une quarantaine d’année bedonnant et trouillard, adepte des feuilletons télévisés et que ses tortionnaires sont un jeune couple sexy, Jason et Amy, la beauté étant d’ordinaire l’apanage des créatures de la nuit. D’ailleurs, Eddy dit à Jason que les gays sont censés lui ressembler – sous entendu, les vampires aussi
Tout au long du show d’Alan Ball, vampires et gays sont intrinsèquement liés : d’ailleurs plusieurs vampires ont des penchants homosexuels. Le personnage de vampire gay le plus signifiant quant à la persécution des homosexuels est sans doute Eddy ; Allan Ball ne se gêne pas pour inverser les valeurs, et Eddy deviendra la victime d’humains qui le séquestrent et le torturent pour prendre son sang (le sang des vampires est un aphrodisiaque puissant). Tout change de place de façon perceptible, puisque le mort-vivant est ici un homme d’une quarantaine d’année bedonnant et trouillard, adepte des feuilletons télévisés et que ses tortionnaires sont un jeune couple sexy, Jason et Amy, la beauté étant d’ordinaire l’apanage des créatures de la nuit. D’ailleurs, Eddy dit à Jason que les gays sont censés lui ressembler – sous entendu, les vampires aussi 





 a sexualité jusqu’au dernier de ses pores et allume ouvertement tout ce qui est mâle dans son entourage, battant outrageusement des cils, bombant la poitrine, et dandinant de la croupe, à l’instar d’à peu près tous les personnages féminins. Comme si l’humidité des bayous, et la chaleur infernale du Sud justifiait ce genre de comportement. On est bien loin de la très sage Bella de Twillight, qui elle, tient son rôle de pucelle très au sérieux, emmitouflée dans des chemises de bûcheron qui ne laissent pas dépasser un centimètre de peau. Sookie semble donc marquée par la débauche exagérée que True Blood s’évertue à nous présenter comme le quotidien en Louisiane. Mais elle est aussi affectée par le malaise sudiste, puisque ses parents sont morts dans une crue, et qu’elle a été sexuellement harcelée par son oncle lorsqu’elle était enfant.
a sexualité jusqu’au dernier de ses pores et allume ouvertement tout ce qui est mâle dans son entourage, battant outrageusement des cils, bombant la poitrine, et dandinant de la croupe, à l’instar d’à peu près tous les personnages féminins. Comme si l’humidité des bayous, et la chaleur infernale du Sud justifiait ce genre de comportement. On est bien loin de la très sage Bella de Twillight, qui elle, tient son rôle de pucelle très au sérieux, emmitouflée dans des chemises de bûcheron qui ne laissent pas dépasser un centimètre de peau. Sookie semble donc marquée par la débauche exagérée que True Blood s’évertue à nous présenter comme le quotidien en Louisiane. Mais elle est aussi affectée par le malaise sudiste, puisque ses parents sont morts dans une crue, et qu’elle a été sexuellement harcelée par son oncle lorsqu’elle était enfant.


 combat est d’autant plus difficile car les suceurs de sang se heurtent aux esprits étroits des rednecks et des bigots. Citons cette phrase du Sénateur Finch lors d’un débat télévisé (saison 2 épisode 11) : « Il ne faut pas donner le droit de vote aux vampires car leur sang transforme nos enfants en drogués et en homosexuels. » Le vampire doit sortir du cercueil et non pas du placard, afin de forcer son intégration dans la société sudiste, intégration parfaitement réussie au Nord par la famille Cullen, avec un patriarche vampire sans soucis d’identité sexuelle, exerçant la profession de médecin, et marié à une séduisante femme au foyer.
combat est d’autant plus difficile car les suceurs de sang se heurtent aux esprits étroits des rednecks et des bigots. Citons cette phrase du Sénateur Finch lors d’un débat télévisé (saison 2 épisode 11) : « Il ne faut pas donner le droit de vote aux vampires car leur sang transforme nos enfants en drogués et en homosexuels. » Le vampire doit sortir du cercueil et non pas du placard, afin de forcer son intégration dans la société sudiste, intégration parfaitement réussie au Nord par la famille Cullen, avec un patriarche vampire sans soucis d’identité sexuelle, exerçant la profession de médecin, et marié à une séduisante femme au foyer. mode de vie mormon, invitant à respecter les institutions familiales et maritales, au sein d’une communauté polie, aimante et unie contre l’adversité. Si les mormons sont des fervents défenseurs de la chasteté jusqu’au mariage, ils prônent cependant la famille nombreuse une fois celui-ci consommé, et pour ce faire, déconseille la contraception et interdise l’avortement ; cela pourrait expliquer que Bella tombe enceinte dès ses premiers rapports dans Breaking Dawn et son acharnement à garder l’enfant en gestation, au péril de sa propre vie. Le sous-texte religieux est clair, même si Meyer s’en défend, l’exemple le plus significatif étant l’apparence d’Edward, qui rappelle celle de l’ange Mormoni, apparu au prophète Joseph Smith en 1823 : un être de chair et de sang, irradiant la lumière et « magnifique au delà de toute description ».
mode de vie mormon, invitant à respecter les institutions familiales et maritales, au sein d’une communauté polie, aimante et unie contre l’adversité. Si les mormons sont des fervents défenseurs de la chasteté jusqu’au mariage, ils prônent cependant la famille nombreuse une fois celui-ci consommé, et pour ce faire, déconseille la contraception et interdise l’avortement ; cela pourrait expliquer que Bella tombe enceinte dès ses premiers rapports dans Breaking Dawn et son acharnement à garder l’enfant en gestation, au péril de sa propre vie. Le sous-texte religieux est clair, même si Meyer s’en défend, l’exemple le plus significatif étant l’apparence d’Edward, qui rappelle celle de l’ange Mormoni, apparu au prophète Joseph Smith en 1823 : un être de chair et de sang, irradiant la lumière et « magnifique au delà de toute description ».
